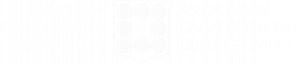Choisir l'inclusion et non l'assimilation
Anaïs Bussières McNicoll et Harini Sivalingam
5 mai 2025
La Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale a récemment terminé ses auditions publiques sur le projet de loi 94[1]. Ce texte étend notamment l'interdiction de port de signes religieux prévue à la Loi 21 à tout le personnel de service des écoles, en plus d'interdire aux étudiants de porter des signes religieux couvrant leur visage et d'interdire les prières visibles à l'école. En parallèle, l'Assemblée nationale poursuit son étude détaillée, en commission parlementaire, du projet de loi 84 suggérant de forcer les nouveaux arrivants et groupes minoritaires à adopter la " culture commune " du Québec[2]. Enfin, dans les dernières semaines, le gouvernement du Québec s'est montré ouvert à interdire les prières en public, par exemple dans les parcs[3].
Cette succession d'événements nous incite à lancer un signal d'alarme à la population. Il va sans dire que la volonté des Québécois.e.s de protéger leur riche culture et l'usage de la langue française au Québec est légitime, tout comme celle d'assurer des environnements d'apprentissage et de travail sains. Ces objectifs devraient toutefois être poursuivis par le biais de mesures respectueuses des droits et libertés fondamentaux de toutes et tous - devoir auquel le gouvernement québécois fait défaut.
En 1839, Lord Durham a, de façon tristement notoire, recommandé l'assimilation des Canadiens français au monde anglo-saxon[4]. Non seulement le jugement posé par Lord Durham sur les Canadiens français était-il complètement erroné, mais ses objectifs d'assimilation étaient également profondément malavisés. Il est paradoxal, voire ironique, que le gouvernement du Québec semble aujourd'hui préconiser, à son tour, une approche assimilationniste, cette fois à l'égard des nouveaux arrivants et groupes minoritaires.
Déformation du concept de laïcité de l'État
Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a, au nom de la laïcité de l'État, interdit le port de symboles religieux par certains employés du secteur public[5]. Cela a forcé de nombreux salariés à choisir entre leur profession et leur foi, privant du même coup l'ensemble de notre société de travailleurs compétents. Le gouvernement a également interdit par décret toute forme de prières visibles à l'école publique, même celles qui n'auraient eu aucun impact négatif sur les élèves, le personnel enseignant et l'environnement d'apprentissage[6]. Par le biais du récent projet de loi 94, le gouvernement persiste dans cette lancée en élargissant l'interdiction du port de signes religieux à tout le personnel de service des écoles et en codifiant l'interdiction de prières visibles à l'école.
Cette vision de la laïcité de l'État est erronée et préjudiciable.
La laïcité de l'État est une composante importante d'une démocratie libérale moderne. Ce principe requiert la séparation de la religion et des institutions gouvernementales, ainsi que la neutralité de l'État envers les religions - des objectifs louables auxquels l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), comme de nombreuses personnes à travers le Canada, adhère. Au nom de la laïcité de l'État, l'ACLC s'oppose d'ailleurs depuis longtemps aux pratiques religieuses coercitives dans nos institutions publiques et lutte contre le financement public des écoles religieuses. Après tout, le droit à la liberté de religion, protégé par les Chartes québécoise et canadienne des droits et libertés, inclut notamment le droit de ne pas être contraint d'observer une religion.
Ainsi, la laïcité de l'État se traduit essentiellement par le droit d'avoir des institutions publiques qui sont exemptes de contrôle religieux. Ce principe ne confère toutefois pas à l'État le droit d'étouffer toute manifestation de la religion dans les espaces publics. Interdire le port de symboles religieux à certains employés du secteur public, bannir les prières visibles dans les écoles et forcer les nouveaux arrivants à adopter une " culture commune " sont des gestes étatiques qui envoient un message d'exclusion et de ségrégation aux nouveaux arrivants et aux groupes minoritaires, au lieu d'un message d'inclusion et de respect des différences religieuses. Ces mesures coercitives imposant la non-religion dans l'espace public sont tout aussi dangereuses que le serait d'imposer une religion à la société.
Utilisation d'incidents comme prétextes pour porter atteinte aux droits des minorités
L'ACLC reconnaît les préoccupations soulevées par des incidents rapportés qui auraient pu contribuer à créer un climat d'apprentissage malsain dans une ou plusieurs écoles du Québec. Cependant, nous déplorons la manière dont ces préoccupations sont utilisées par le gouvernement pour tenter de justifier des atteintes non-reliées et inacceptables aux droits de groupes minoritaires.
Soyons clairs : un climat d'apprentissage toxique à l'école ne devrait pas être toléré. Des protections statutaires sont déjà en place pour lutter contre ce type de phénomènes, notamment par l'intermédiaire du Protecteur national de l'élève[7]. Il appartient au gouvernement de veiller à ce que ces protections soient efficaces. Il existe par ailleurs une jurisprudence bien établie qui autorise des restrictions à la liberté de religion dans le contexte scolaire afin de protéger d'autres droits et valeurs fondamentaux, tels que l'égalité des sexes[8].
Interdire le port de symboles religieux, tout comme bannir la prière en public, sont des coups d'épée dans l'eau qui n'empêcheraient ni les climats d'apprentissage toxiques ni l'endoctrinement à l'école. Ce sont plutôt la responsabilisation du gouvernement et son engagement à financer et à mettre en œuvre de manière adéquate les protections existantes qui le feront.
Le gouvernement du Québec ne devrait pas suggérer à sa population que la seule option disponible pour protéger la culture québécoise est une autre législation discriminatoire dérogeant aux droits fondamentaux. Le gouvernement devrait encore moins invoquer la clause dérogatoire pour déroger impunément aux droits de la personne. La province devrait plutôt inviter les nouveaux arrivants et les groupes minoritaires à partager leurs propres langues, cultures et traditions, tout en leur donnant les outils nécessaires pour intégrer la riche culture québécoise et apprendre le français.
Anaïs Bussières McNicoll est Directrice du programme Libertés fondamentales à l'Association canadienne des libertés civiles. Elle est originaire de Montréal, Québec.
Harini Sivalingam est Directrice du programme Égalité à l'Association canadienne des libertés civiles. Elle mène la contestation de la Loi 21 pour l'ACLC.
[1] Assemblée nationale, Projet de loi no. 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives, 43e lég. (Qc), 1ré sess., 20 mars 2025, en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-94-43-1.html.
[2] Assemblée nationale, Projet de loi no. 84, Loi sur l'intégration nationale, 43e lég. (Qc), 1ré sess., 30 janvier 2025, en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-43-1.html.
[3] Voir Stéphane Bordeleau, Radio-Canada, " Québec compte muscler la loi sur la laïcité face aux " dérives religieuses ", 10 mars 2025, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2146920/laicite-religion-loi-21.
[4] John Durham, Haut-commissaire de Sa Majesté, "Report from the Select Committee of the House of Assembly of Upper Canada, appointed to report on the state of the province", (Londres : 1839), p. 94 et 95.
[5] Loi sur la laïcité de l'État, RLRQ, c. I-03, en ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-0.3.
[6] Gazette officielle du Québec, Partie 2, 19 avril 2023, Décret 707-2023, en ligne : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2023F/79651.pdf.
[7] Loi sur le protecteur national de l'élèveRLRQ, c. P-32.01, en ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-32.01.
[8] Voir notamment Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32 ; École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12.
À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles
L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.
Pour les médias
Pour d'autres commentaires, veuillez nous contacter à media@ccla.org.
Pour les mises à jour en direct
Veuillez continuer à vous référer à cette page et à nos plateformes de médias sociaux. On est dessus Instagram, Facebook, Twitter et Ciel bleu.